| Cyril Mariaux |
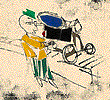 |
|
RIEN
n'est plus irritant et affligeant pour l'esprit que cette furieuse manie qu'ont
nos jeunes réalisateurs de s'emparer pour leurs films de ce qu'on appelle
pudiquement, par un euphémisme que je réprouve, des faits de société.
Non que je veuille interdire à un réalisateur de prendre son
bien où il le trouve : les sujets qui donnent naissance à l'oeuvre
d'art sont infinis dans leur variété : Proust explore le domaine
du « monde » comme Céline celui du mauvais chemin, mais leurs
oeuvres sont strictement identiques par leur génie : un film peut très
bien emprunter à Euripide comme Malraux s'est inspiré de la
guerre d 'Espagne : les chemins de l'écriture sont infinis. Mais ce qui
me choque, c'est de voir nos apprenti-sorciers se fabriquer une cuirasse de
justicier, posant leur caméra sur les plus cruels problèmes - je déteste
ce mot - que sont les exclus, les SDF ou la banlieue, non pas pour tenter de les
résoudre ou même de les apaiser avec le recul qu'impose l'¦uvre
d'art, mais au contraire, pour les multiplier ; ne pas dénoncer la
violence qui les caractérise mais au contraire s'en réjouir en se
drapant dans les défroques des droits de l'homme ou du justicier. Ce que
je dénonce ici, à propos de l'exemple de la Haine, c'est la façon
dont on s'empare de la chose, la banlieue par exemple, non pas pour réfuter
cette violence, cette haine, mais au contraire l'amplifier et donner naissance à
plusieurs générations d'incendiaires de voitures, de plastiqueurs,
qui espèrent au bout du compte, eux aussi être encensés,
pardonnés, filmés.
Aussi ne s'étonneront-t-ils pas, lorsqu'ils poussent la porte des
salles obscures, de rencontrer à nouveau cet univers de damnés :
des dealers, des agressions dans le métro, des lycéennes qui n'entôlent
des quinquagénaires que pour les offrir aux canifs de leur ami : avec ces
sujets, on vous bâcle vite un semblant d'histoire et le tour est joué.
En fait ce que le public réclame, mais il a oublié depuis
longtemps, ce sont de belles et profondes histoires d'amour et de mort, des
contes et des légendes, où la caméra joue son véritable
rôle qui est de photographier la vérité vraie au delà
du réel qu'elle appréhende, d'être comme le dit Mizoguchi,
un regard agissant, un regard qui à son tour donne à voir, bref
une fenêtre ouverte sur une réalité plus vraie que vraie.
Les films de ce type abondent : je ne cite que ceux qui me viennent à
l'esprit à la minute : les ¦uvres de Visconti, de John Ford, de
Murnau, de Raoul Walsh qui, bien loin de s'enfermer dans une tour d'ivoire, sont
descendus dans l'arène et se sont coltinés avec la plus dure des réalités.
Réalités dont notre cinéma français, empêtré
qu'il est dans un lyrisme à la Prévert, n'a jamais su donner une
image vraie. C'est dans Les nus et les morts de Raoul Walsh qu'on voit cette scène
étonnante, impossible dans un film français, d'un simple soldat
tirant une balle dans la tête d'un adjudant borné. Je ferais
remarquer également que c'est Stanley Kubrick, après Faulkner, qui
dans Les chemins de la gloire, interdit en France bien entendu, a montré
les mutineries de 17, leur répression, le désespoir de nos
soldats.
Je ne voudrais pas qu'on me traite de passéiste, ni d'esprit réactionnaire.
Il me suffit de citer deux films français, qui chacun à leur manière,
illustrent d'une façon convaincante ce que à mes yeux devrait être
le cinéma.
Je veux parler du Capitaine Conan de Bertrand Tavernier. Outre son attitude
outragée et outrageante, la guerre est montrée avec son visage
vrai : qui est un terrible jeu de massacre lié à la joie,
ancestrale, d'exterminer son semblable et d'en tirer des motifs de satisfaction.
Le second film qui me touche peut-être davantage est La servante amoureuse
de Jean Touchet, d'après Goldoni, et joué par les comédiens
du Théâtre français. En même temps qu'une illutration
de mise en scène exemplaire, ce qui n'est pas étonnant de la part
d'un critique scrupuleux vénérant Fritz Lang, Losey, Misoguchi, ce
film est aussi la preuve par neuf de filmer une pièce de théâtre
: c'est à dire de filmer le texte et non pas les acteur lisant le texte,
par une approche raisonnée et patiente de ces mêmes comédiens.
Ces deux films dans le désert de l'époque sont comme une note
d'espoir : « le pire n'est jamais le plus sûr », comme le disait
Claudel. Aussi entre La Haine et ses ersatz, je me permets de recommander ces
deux films, c'est tout le mal que je souhaite à mes contemporains.